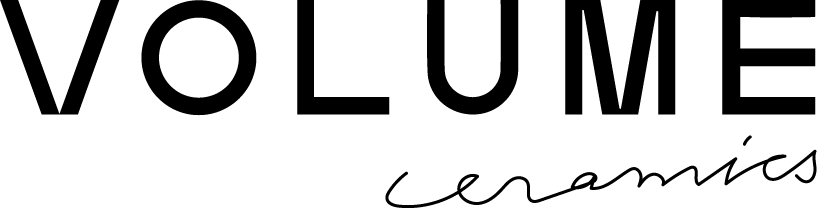Rencontre avec Juliette Pénélope Pépin
Parle-nous un peu de ton parcours, qu’est-ce qui t’a menée vers la terre ?
Paradoxalement, j’ai mis longtemps à entrer véritablement en dialogue avec la terre, malgré des débuts précoces. Mes parents m’avaient inscrite, vers 8 ou 9 ans, à un atelier d’arts plastiques où j’ai eu la chance de découvrir la sculpture en argile avec en fond sonore TSF Jazz. J’y émaillais aussi mes productions dans un tout petit four de cuisson. Je me souviens de mon tout premier objet en céramique, une petite femme nue (évidement...) porte-encens en émail rouge bordeaux. Je crois que ma mère l’a encore. Un peu plus tard, mes parents m’ont offert un tour électrique en plastique de chez JouéClub. Je l’adorais, même s’il a surtout servi à recouvrir le salon de barbotine.
 Ensuite, j’ai eu l’opportunité d’étudier à la Design Academy Eindhoven, où j’ai découvert une approche plus technique et designo-industrielle de la céramique, avec des pratiques comme le moulage en plâtre et la coulée. Je me souviens ne pas avoir particulièrement apprécié la rigidité des formes demandées à cause de leurs contraintes de reproductibilité.
Ensuite, j’ai eu l’opportunité d’étudier à la Design Academy Eindhoven, où j’ai découvert une approche plus technique et designo-industrielle de la céramique, avec des pratiques comme le moulage en plâtre et la coulée. Je me souviens ne pas avoir particulièrement apprécié la rigidité des formes demandées à cause de leurs contraintes de reproductibilité.
Après mon diplôme, j’ai brièvement co-dirigé la galerie FRACAS à Bruxelles avec Romain Les Bains (son directeur actuel, céramiste lui aussi d’ailleurs), qui m’a transmis sa passion pour la céramique contemporaine. Il m’a emmenée visiter des ateliers bruxellois, et ces expériences ont renforcé mon envie de reprendre mon parcours artistique à travers un master.
C’est à Goldsmiths, University of London, que j’ai développé une approche plus artistique et sculpturale de la terre. Mon projet de diplôme consistait en une série de sculptures en grès, inspirées par une interprétation poético-critique de l’anatomie des grenouilles et des humains. Ce travail m’a conduite au Japon, où ma passion pour la céramique s’est véritablement réactivée. J’ai pris des cours dans l’atelier Asahiyaki à Uji et pratiqué de manière autonome (et maladroite) dans les superbes ateliers de l’Université des arts de Kyoto.
À mon retour du Japon, j’ai su que la céramique occuperait une place centrale dans ma vie. J’ai commencé à créer des vases en colombin tourné, tout en m’investissant intensément dans l’Atelier de Paix à Magny-le-Hongre. Ce lieu associatif extraordinaire, créé par un prêtre ouvrier dans les années 1980, est aujourd’hui géré par Nicole Cragnolini, qui m’a formée avec une grande générosité. En parallèle, j’ai rencontré Marie Biaudet, une artiste et amie spécialisée dans la cuisson raku. Ensemble, nous réalisons nos cuissons à l’atelier Sculpture Paris Montreuil.
Après cet apprentissage long et éclectique, j’ai décidé de me former sérieusement au tour électrique, une étape importante pour tout·e céramiste, et je suis actuellement en formation chez Vents et Courbes.
Mon dialogue avec la terre est donc ancien, mais il a été réactivé à plusieurs reprises grâce à des rencontres marquantes et des lieux où je me suis retrouvée parfois par hasard. C’est, pour moi, la beauté du métier de potier.e- créateur·rice : une pratique nourrie par les liens humains et les hasards du parcours.
Enfin, j’entretiens une réflexion personnelle et politique autour des notions de travail artisanal, artistique et appliqué, ainsi que sur le lien entre matière, main et utilité. Mais cela, j’aime mieux en parler de vive voix.
D’où vient ton inspiration ?
Comme de nombreux·ses céramistes et designers, je suis fascinée par la céramique coréenne, japonaise et scandinave des années 40-70 (Axel Salto, par exemple). J’admire aussi énormément la céramique iranienne des années 1200. Par ailleurs, des céramistes de La Borne comme Hervé Rousseau ou Dalloun m’inspirent beaucoup.
Je trouve aussi la scène contemporaine des jeunes créateur·rices particulièrement passionnante, notamment des initiatives collectives comme ARC ou le travail de céramistes tels qu’Adélaïde Renault. Mais mon inspiration dépasse souvent le champ de la céramique.
Un “héritage” essentiel pour moi est ce que j’ai appris sur la couleur dans les cours de Mathieu Meijers à la Design Academy. Sa méthode, que j’applique encore aujourd’hui, propose une manière de penser la forme, son dynamisme et sa “vibration” à travers la couleur et la texture qui la recouvrent. Ainsi, mes vases naissent toujours d’une conversation entre leur structure et leur futur revêtement : glaçure, engobe, sigillée, nudité, etc.
Quand mes pièces s’inscrivent dans des projets de recherche – car je suis artiste-chercheuse – mon inspiration découle directement du sujet exploré. Par exemple, je vais bientôt effectuer une résidence au Centre d’art Madeleine Lambert à Vénissieux. Mon travail s’inspirera des traces archéologiques de ce territoire, en lien avec des notions de mémoire vive et de mythologie spéculative.
Peux-tu nous en dire plus à propos des pièces que tu as créées pour Volume Ceramics et nous expliquer le processus de tes cuissons ?
C’est assez incroyable, car Volume a acquis ce que je définirais comme étant les premières pièces majeures de mes deux premières collections. J’aime parler de collection, car cela détermine en grande partie la manière dont j’aborde la création de mes vases. Une collection est pour moi un champ d’exploration où j’épuise une forme et sa fusion avec la couleur et la texture.
La collection, ou série, S(E)AMS – un jeu de mots entre seems (sembler, en anglais) et seams (coutures, jointures) – est le fruit d’un essai sans prétention. Mon tout premier S(E)AMS était un petit vase que j’ai légué à l’initiative Lot commun. C’était à l’origine un test d’application de barbotine à la poire pour créer des bas-reliefs en raku. Mais le résultat s’est révélé si percutant que je me suis mise à en produire davantage, explorant des formes rebondies qui mettent en valeur ces coutures, presque comme des robes-bonbons (une référence personnelle, mais je pense ici aux robes volumineuses dans certains films Disney). Plus récemment, j’ai également adapté les pièces à des formes évoquant des fleurs, notamment celles de type Papavéracées avant leur éclosion.
D’un point de vue technique, ces vases sont modelés en colombins tournés manuellement sur une girelle en fonte (une technique apprise au Japon). J’utilise une terre Rakumitsu, et ces pièces sont ensuite cuites en raku avec un émail fabriqué par Marie Biaudet, surnommé émail Lune. J’apprécie particulièrement cet émail, et je tenais à le mentionner.
 Mon autre collection majeure, Lipari, est née d’une passion un peu secrète que j’entretiens pour les musées d’archéologie, en particulier leur muséographie et leur manière de présenter la céramique, souvent sous forme de fragments. J’admire beaucoup la céramique néolithique européenne et celle de la période Jōmon au Japon, notamment pour les jeux de combustion qui ornent souvent leurs formes élancées et rebondies. C’est en partie pour cela que je me suis tournée vers la sigillée. Bien qu’elle soit une pratique essentiellement gréco-romaine (et non préhistorique), elle offre des résultats en enfumage qui résonnent avec cette passion secrète pour les effets muséo-archéo-combustibles.
Mon autre collection majeure, Lipari, est née d’une passion un peu secrète que j’entretiens pour les musées d’archéologie, en particulier leur muséographie et leur manière de présenter la céramique, souvent sous forme de fragments. J’admire beaucoup la céramique néolithique européenne et celle de la période Jōmon au Japon, notamment pour les jeux de combustion qui ornent souvent leurs formes élancées et rebondies. C’est en partie pour cela que je me suis tournée vers la sigillée. Bien qu’elle soit une pratique essentiellement gréco-romaine (et non préhistorique), elle offre des résultats en enfumage qui résonnent avec cette passion secrète pour les effets muséo-archéo-combustibles.
Pour simplifier, la sigillée consiste à récupérer des particules fines d’argile (principalement de faïence) que j’utilise comme engobe. Cela produit un effet jaune-orange-ocre-feu satiné. Pour être honnête, je suis très difficile en matière d’émaux – surtout ceux qui sont vitrifiés et très brillants. C’est pourquoi je privilégie des recherches de surface mates ou satinées. Mes pièces, toujours modelées en colombins tournés sur girelle, sont ensuite enfumées après une cuisson dans un four à raku.
 Quant au raku, c’est le premier mode de cuisson que j’ai véritablement expérimenté (après une entrevue fascinante avec le four à bois Anagama du céramiste Takumi Miyagi au Japon). Aujourd’hui, il m’est presque inconcevable de cuire autrement, à l’exception peut-être des fours à bois ou gréco-romains. Le raku, pour résumer, consiste en une cuisson rapide à environ 900 °C. Les pièces encore en fusion sont ensuite plongées dans des matériaux combustibles comme des sciures de bois, du papier journal, de la levure fermentée, ou autres concoctions selon l’effet recherché. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vous encourage à explorer les nombreuses ressources disponibles en ligne. Sinon, je vous invite à participer aux ateliers raku de Marie à Sculpture Paris Montreuil.
Quant au raku, c’est le premier mode de cuisson que j’ai véritablement expérimenté (après une entrevue fascinante avec le four à bois Anagama du céramiste Takumi Miyagi au Japon). Aujourd’hui, il m’est presque inconcevable de cuire autrement, à l’exception peut-être des fours à bois ou gréco-romains. Le raku, pour résumer, consiste en une cuisson rapide à environ 900 °C. Les pièces encore en fusion sont ensuite plongées dans des matériaux combustibles comme des sciures de bois, du papier journal, de la levure fermentée, ou autres concoctions selon l’effet recherché. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vous encourage à explorer les nombreuses ressources disponibles en ligne. Sinon, je vous invite à participer aux ateliers raku de Marie à Sculpture Paris Montreuil.
Est-ce que tu écoutes de la musique ou des podcasts à ton atelier ? Tu peux nous partager ta playlist ?
Oui, absolument ! J’écoute beaucoup NTS, notamment leurs shows Obsidian dreams, Time is away, United in flames, Braden Wells, Tommasi.... Il faut aussi mentionner les mix de ma bff DJ-photographe SkyScanner (Charlotte Robin).
Côté podcasts, j’apprécie particulièrement Les pieds sur terre sur France Culture, Vivons heureux avant la fin du monde sur Arte Radio, et À l’air libre de Mediapart.
Comment vois-tu ta pratique évoluer ?
À court terme, j’aimerais développer des pièces plus grandes et davantage de créations sur mesure. J’ai la chance d’être entourée d’ami.e.s talentueux.euses avec qui je souhaiterais collaborer, notamment pour des commandes spécifiques. Par exemple, je vais surement développer des poignées de porte en sigillée.
J’aimerais aussi concevoir une série de pieds de lampe dans un style qui fusionne l’esthétique Lipari avec les grosses lampes à abat-jour géant des années 60-70.
 Par ailleurs, j’ai une résidence à Vénissieux cette année qui m’enthousiasme énormément.
Par ailleurs, j’ai une résidence à Vénissieux cette année qui m’enthousiasme énormément.
À plus long terme, j’aimerais évidemment ouvrir mon propre atelier. Mais, de façon plus singulière, je souhaite continuer à écrire et à réfléchir de manière critique. J’aimerais, en temps voulu, proposer une thèse qui mêlerait terre, politique, forme, et théorie critique de manière sincère, dans le cadre d’un doctorat pluridisciplinaire.
Cela dit, rien ne presse. Pour l’instant, je veux continuer mes collections, terminer ma formation, potentiellement travailler à l’Atelier de Paix, et peut-être passer mon CAP de tournage (pour ajouter à ma collection de diplômes que personne ne me demande jamais).